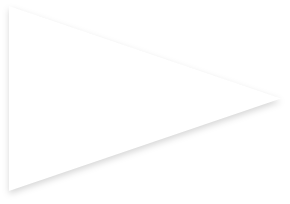Ce que les cohortes bretonnes EDITH et BREIZH nous ont appris

Par Raphael Le Mao et Anne-sophie Morvan :
Pourquoi ces cohortes comptent
Depuis plus de vingt ans, des équipes du CIC Thrombose du CHU de Brest suivent des milliers de personnes pour mieux comprendre la « maladie veineuse thrombo-embolique » (MVTE) — c’est-à-dire les phlébites (caillots dans les veines des jambes ou des bras) et les embolies pulmonaires (caillots migrés vers les poumons). Deux projets phares structurent ce travail : EDITH, qui explore les facteurs de risque de faire une première MVTE, et BREIZH, qui suit les personnes après une embolie pulmonaire pour anticiper les récidives et adapter les traitements. Ces études ont débouché sur des résultats très concrets pour mieux prévenir, traiter et surveiller la MVTE.
Ce qui favorise un premier épisode de caillot (EDITH)
EDITH a montré que certains éléments biologiques et familiaux augmentent vraiment le risque de faire un caillot. Par exemple, un excès d’homocystéine dans le sang (souvent lié à un manque de vitamines B) est associé à un risque plus élevé de MVTE ; ce sont des paramètres simples que l’on peut corriger avec l’alimentation ou des compléments quand c’est indiqué (1). Des variations d’un gène qui intervient dans le métabolisme de la vitamine K (VKORC1) sont aussi liées au risque de MVTE — utile à connaître lorsqu’on discute du traitement par antivitamine K (2). L’histoire familiale compte : avoir des proches au premier degré ayant eu une MTEV multiplie le risque, même lorsqu’on ne retrouve pas d’anomalie génétique « classique » ; cela aide à mieux cibler la prévention (3).
EDITH a également évalué des médicaments courants : certaines classes d’antipsychotiques augmentent le risque de MTEV, ce qui incite à surveiller davantage et à prévenir lors d’autres facteurs de risque temporaires (4). À l’inverse, l’étude n’a pas retrouvé de surrisque évident avec la plupart des antihypertenseurs en dehors de situations particulières (5). EDITH a enfin rappelé que de nombreuses petites variations génétiques, prises ensemble, peuvent contribuer à un risque de MTEV sans qu’une seule mutation « explique tout » (6), et que certaines anomalies, comme le facteur V Leiden chez les personnes atteintes de cancer, pèsent davantage que chez d’autres (7).
À quelle fréquence la MTEV survient-elle en population ?
Les équipes brestoises ont mesuré l’incidence de la MTEV « dans la vraie vie » dans le Finistère. Au tournant des années 2000, on observait environ 1,8 épisode pour 1 000 habitants par an — et cette fréquence augmente fortement avec l’âge (8). Quinze ans plus tard, la photographie a évolué (meilleurs examens, meilleure prévention) : certaines formes baissent, d’autres non, ce qui aide les autorités de santé à ajuster les priorités de dépistage et de prévention (9). On a aussi précisé des formes moins connues, comme les thromboses veineuses du membre supérieur, dont l’incidence régionale a été estimée précisément (10).
Après une embolie pulmonaire : qui risque de récidiver ? (BREIZH)
BREIZH a mis en lumière un marqueur d’imagerie simple et puissant : le « taux d’obstruction vasculaire pulmonaire » (PVOI), c’est-à-dire la proportion du poumon encore mal perfusée par le sang à cause des séquelles du caillot. Quand ce taux est très élevé au diagnostic (≈ 40 % ou plus), le risque de refaire une embolie est significativement plus important au long cours, ce qui peut conduire le médecin à proposer une anticoagulation plus longue (11).
Autre message rassurant : on peut mesurer ce PVOI simplement et de manière fiable sur une scintigraphie ventilation-perfusion, sans outils complexes ; cela facilite son usage en routine (12).
BREIZH et un grand regroupement international de données individuelles ont aussi montré que même une petite obstruction résiduelle (≥ 5 % après les 3–6 premiers mois de traitement) double à peu près le risque de récidive à un an, comparé à une scintigraphie redevenue normale (13). Enfin, BREIZH a identifié des profils de patients plus à risque de garder des séquelles au poumon après l’épisode initial, ce qui aide à planifier le suivi (14).Ces informations doivent cependant être validées par de plus larges études.
Situations particulières étudiées à Brest
Certaines maladies ou contextes font varier le risque et la prise en charge. Dans les pneumopathies interstitielles (maladies du tissu pulmonaire), le risque de récidive après l’arrêt des anticoagulants est très élevé, et le risque d’hémorragie sous traitement l’est aussi : l’équipe recommande donc d’éviter de prolonger les anticoagulants au-delà de 3–6 mois dans la plupart des cas, sauf raison forte (15).
Dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la cohorte brestoise a montré une incidence de MVTE élevée (environ 3 % par an) et un risque de récidive marqué juste après l’arrêt du traitement ; certains signes (ventilation non-invasive, antécédents familiaux) permettent d’identifier les personnes à surveiller de près (16).
À l’inverse, chez les personnes avec BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), avoir une BPCO n’augmente pas, à lui seul, le risque de refaire une MVTE après un premier épisode ; là encore, cela aide à personnaliser la durée du traitement (17).
Et le risque « artériel » après une MTEV ?
Au-delà des caillots veineux, plusieurs travaux menés avec l’équipe brestoise ont montré qu’après une MTEV, des événements artériels (infarctus, AVC, ischémies de membres) ne sont pas rares et sont davantage liés aux facteurs cardio-vasculaires « classiques » (âge, hypertension, diabète, antécédents d’athérome) et au caractère non provoqué de la MTEV (18–20). Connaître ce profil incite à (re)mettre l’accent, après l’épisode veineux, sur la prévention cardio-vasculaire de fond (pression, sucre, tabac, activité).
Ce que cela change pour les patients
Concrètement, ces résultats permettent d’adapter la durée des anticoagulants et l’intensité du suivi à votre situation personnelle plutôt que d’appliquer une règle unique. Ils expliquent aussi pourquoi votre équipe peut vous proposer une scintigraphie de contrôle, s’intéresser à votre histoire familiale, à certains médicaments, ou renforcer la prévention cardio-vasculaire après un épisode. N’hésitez pas à poser toutes vos questions : les décisions se prennent au cas par cas, en équilibrant risque de récidive et risque de saignement.
Références
Oger E, Lacut K, Le Gal G, et al. Hyperhomocysteinemia and low B vitamin levels are independently associated with venous thromboembolism: results from the EDITH study. J Thromb Haemost. 2006;4(4):793-799. PubMed
Lacut K, Larramendy-Gozalo C, Le Gal G, et al. Vitamin K epoxide reductase genetic polymorphism is associated with venous thromboembolism: results from the EDITH Study. J Thromb Haemost. 2007;5(10):2020-2024. PubMed
Noboa S, Le Gal G, Lacut K, et al. Family history as a risk factor for venous thromboembolism. Thromb Res. 2008;122(5):624-629. PubMed
Lacut K, Le Gal G, Couturaud F, et al. Association between antipsychotic drugs, antidepressant drugs and venous thromboembolism: results from the EDITH case-control study. Fundam Clin Pharmacol. 2007;21(6):643-650. Wiley Online Library
Belattar FZ, Delluc A, Le Gal G, et al. Antihypertensive drugs and risk of venous thromboembolism: results from the EDITH case-control study. Fundam Clin Pharmacol. 2010;24(2):255-259. PubMed
Delluc A, Gourhant L, Lacut K, et al. Association of common genetic variations and idiopathic venous thromboembolism. Results from EDITh. Thromb Haemost. 2010;103(6):1161-1169. PubMed
Héraudeau A, Delluc A, Le Henaff M, et al. Risk of venous thromboembolism in association with factor V Leiden in cancer patients—The EDITH case-control study. PLoS One. 2018;13(5):e0194973. PLOS
Oger E; EPI-GETBP Study Group (GETBO). Incidence of venous thromboembolism: a community-based study in Western France. Thromb Haemost. 2000;83(5):657-660. PubMed
Delluc A, Tromeur C, Le Ven F, et al. Current incidence of venous thromboembolism and comparison with 1998: a community-based study in Western France. Thromb Haemost. 2016;116(5):967-974. Thieme
Delluc A, Tromeur C, Le Mao R, et al. Incidence of upper-extremity deep vein thrombosis in Western France. Haematologica. 2019;104(7):e310-e313. Europe PMC
Orione C, Tromeur C, Le Mao R, et al. The impact of pulmonary vascular obstruction on the risk of recurrence of pulmonary embolism: a French prospective cohort. Thromb Haemost. 2021;121(7):955-963. PubMed
Le Pennec R, Tromeur C, Orione C, et al. Quantification of the pulmonary vascular obstruction index on V/Q scintigraphy: comparison of a segmental visual scoring to the Meyer score. Front Med. 2022;9:851935. PMC
Robin P, Le Pennec R, Eddy M, et al. Residual pulmonary vascular obstruction and recurrence after acute pulmonary embolism: an individual participant data meta-analysis. J Thromb Haemost. 2023;21(6):1519-1528.e2. PubMed
Picart G, Robin P, Tromeur C, et al. Predictors of residual pulmonary vascular obstruction after pulmonary embolism: results from a prospective cohort study. Thromb Res. 2020;194:1-7. PubMed
Le Mao R, Ropars T, Tromeur C, et al. Risk of recurrent venous thromboembolism and bleeding in patients with interstitial lung disease: a cohort study. J Thromb Thrombolysis. 2022;53(1):67-73. PubMed
Barnabé A, Genestet S, Gut-Gobert C, et al. Venous thromboembolism and amyotrophic lateral sclerosis (VESLA Study). Res Pract Thromb Haemost. 2024;8(1):102287. PubMed
Le Mao R, Tromeur C, Dauphin C, et al. Risk of recurrent venous thromboembolism in COPD patients: results from a prospective cohort study. Eur Respir J. 2017;50(1):1700094. PubMed
Noumegni SR, Didier R, Mansourati V, et al. Risk factors of arterial thrombotic events after unprovoked venous thromboembolism, and after cancer-associated venous thromboembolism: a prospective cohort study. Thromb Res. 2022;214:93-105. PubMed
Noumegni SR, Tromeur C, Hoffmann C, et al. Risk Factors of Arterial Events in Patients with Venous Thromboembolism: A Systematic Review and Meta-analysis. Thromb Haemost. 2022;122(4):590-599. PubMed
Noumegni SR, Tromeur C, Hoffmann C, et al. Predictors of Recurrent Venous Thromboembolism or Arterial Thrombotic Events during and after Anticoagulation for a First Venous Thromboembolism. Semin Thromb Hemost. 2023;49(7):688-701. PubMed